
The Thread of Life
6/ 2 votes
Réalisateur(s) : Owen Crump
Avec : Frank BaxterMel BlancDon Grady
Pays d'origine : United States of America
Date de sortie : 1960-12-09
Budget : $0.00
Box Office : $0.00
Durée : 00h53mn
Vous aimerez peut-être
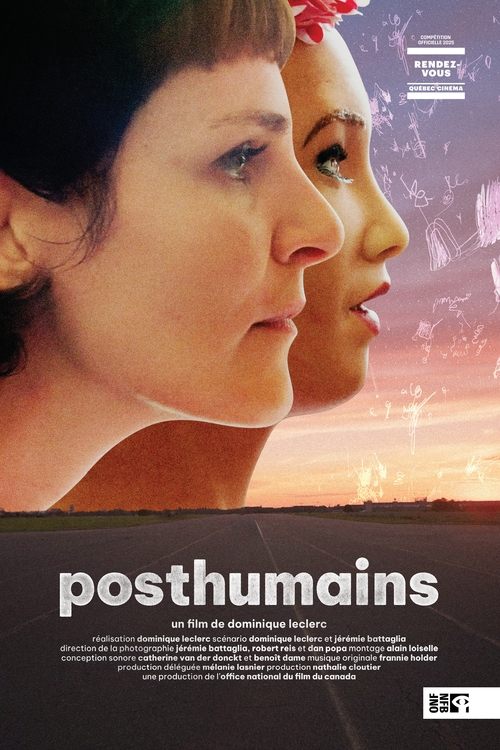
Posthumains
8
2025
À travers la rencontre de cyborgs, de biohackers et de transhumanistes, Posthumains explore les appréhensions et les espoirs liés aux technologies visant à augmenter les capacités humaines.
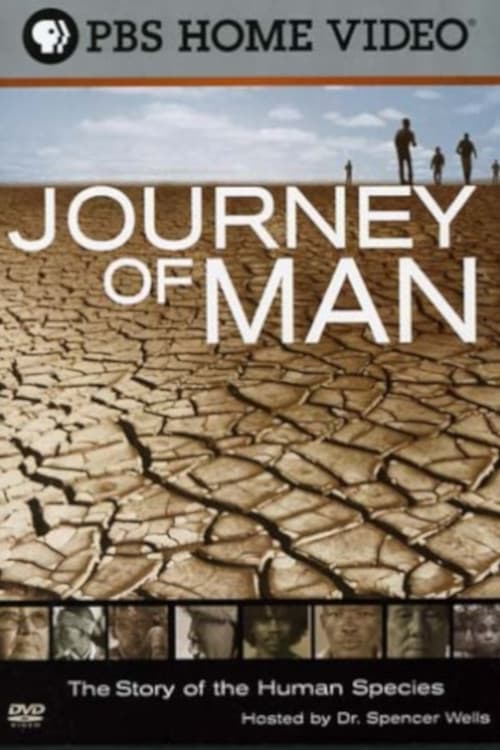
The Journey of Man: A Genetic Odyssey
7.2
2003
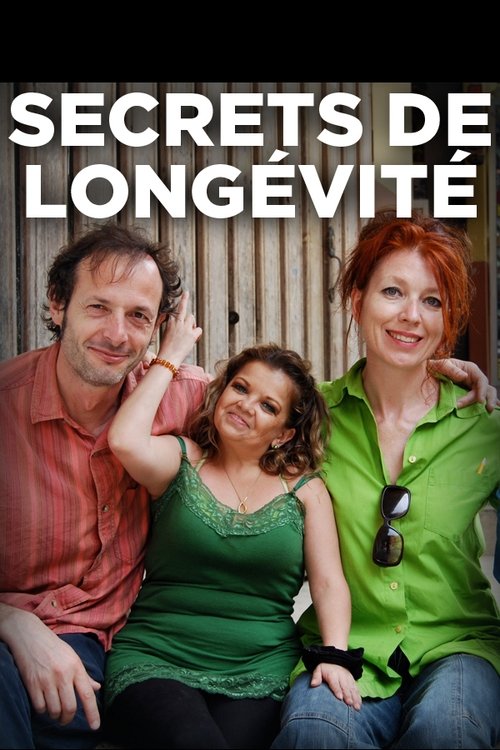
Secrets de longévité
0
2013
Dans une vallée reculée du sud de l'Équateur, le docteur Jaime Guevara rencontre un jour une population d'hommes et de femmes de petite taille, 1,20 mètre en moyenne, et observe qu’ils n’ont ni diabète ni cancer. Il publie ses observations mais personne ne le croit… Valter Longo, lui, dirige des recherches sur le vieillissement à l’université de Los Angeles. Son but : repousser les limites de la longévité. Il étudie notamment une levure qui vit dix fois plus longtemps que la moyenne. Rapporté à l’homme, cela équivaudrait à huit cents années supplémentaires… Les routes de ces deux hommes vont se croiser, et c’est le début d’une grande aventure scientifique. Par quels mécanismes les petits hommes équatoriens sont-ils protégés de certains maux ? De Quito à Los Angeles en passant par Tel-Aviv, le film suit pas à pas le cheminement d’une recherche révolutionnaire pour la compréhension et la prévention des maladies.

A Dangerous Idea
8
2016
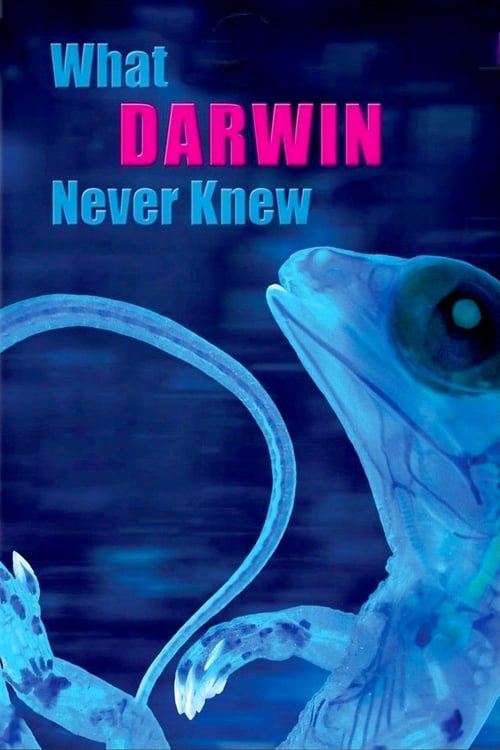
What Darwin Never Knew
9
2009
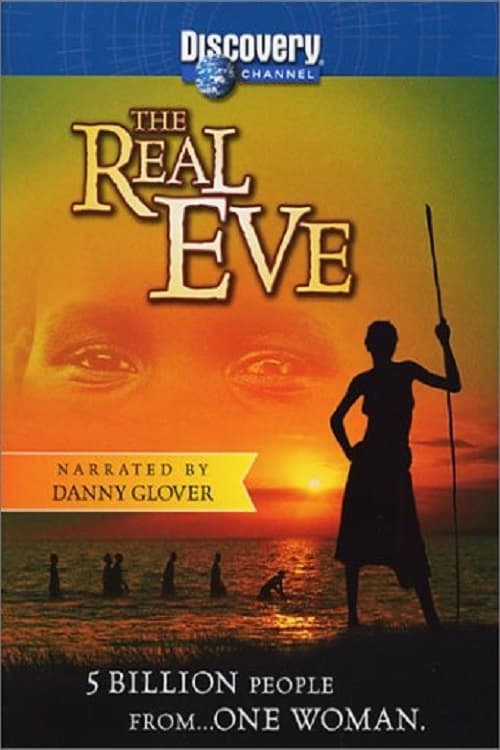
The Real Eve
10
2002
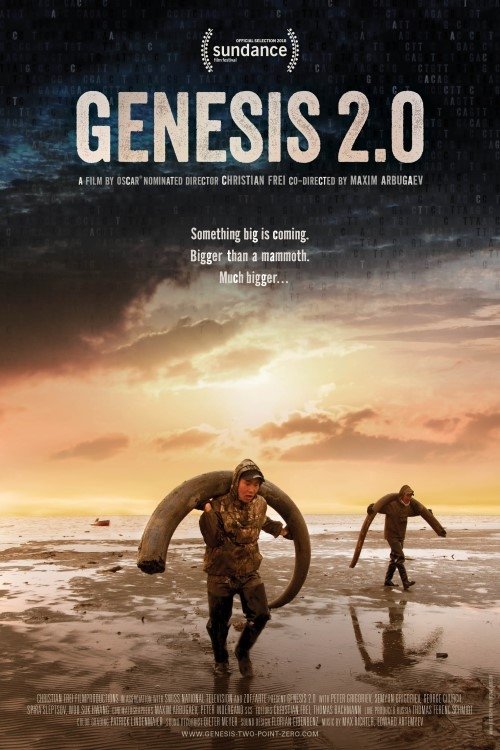
Genesis 2.0
6.4
2018
Sur les lointaines îles de Nouvelle-Sibérie, dans l’océan arctique, des chasseurs prospectent, à la recherche de défenses des mammouths disparus. Un jour, ils découvrent un cadavre de mammouth étonnamment bien conservé. La résurrection du mammouth laineux est l’une des premières manifestations de la prochaine grande révolution technologique – la génétique. Elle pourrait bouleverser notre monde.
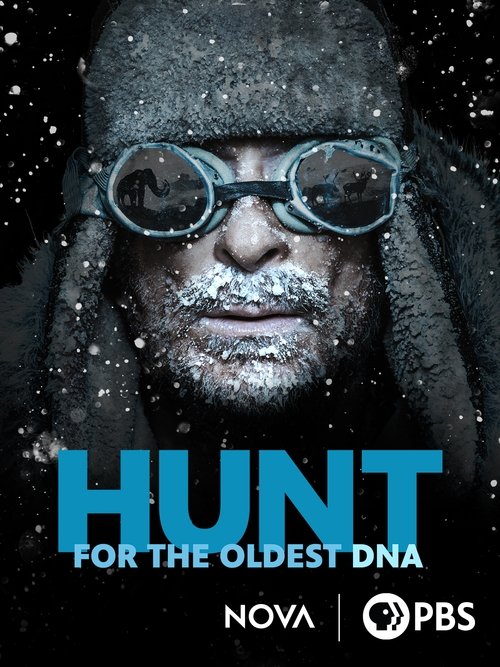
Sur les traces du plus ancien ADN
8
2024
Il y a trois millions d'années, des chameaux parcouraient les vastes forêts du Groenland. C'est l'extraordinaire découverte faite par une équipe de scientifiques sous la supervision du chasseur de gènes Eske Willerslev. Ces biologistes ont en effet pu récolter des fragments d'ADN ancien là où personne n'avait songé à en chercher.
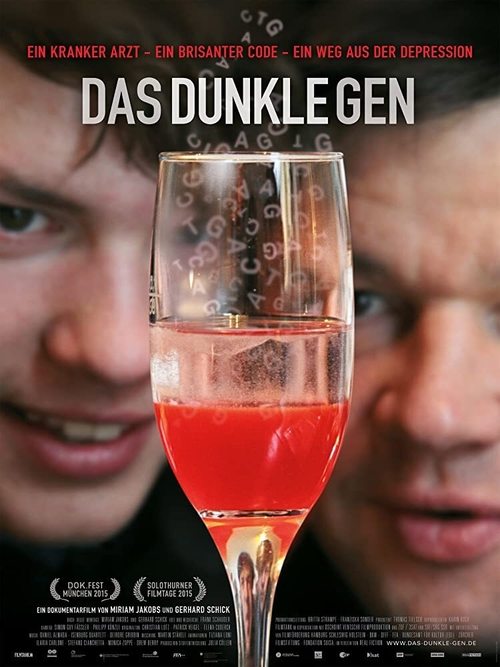
Le gène sombre
8
2015
Un médecin malade, un code à lactualité brûlante, la consolation de lart: en cherchant lorigine de sa dépression, Frank Schauder est mis face à des questions existentielles, confronté à des perspectives davenir radicales, et entraîné dans des mondes visuels et sonores époustouflants. La quête des racines de sa maladie le conduit dans le règne de ses propres gènes, éclairant en même temps les bouleversements fondamentaux qui attendent la société moderne du fait des progrès fulgurants du séquençage du génome. Mais le film ne s'arrête pas au point de vue scientifique. Il explore au contraire des perspectives artistiques et ludiques sur la structure génétique. Ces perspectives brisent lapparent déterminisme de la génétique, aident le protagoniste dans son combat contre la maladie et permettent, malgré la souffrance, de porter un regard réconfortant sur la singularité de lexistence.

Notre part animale - Le poisson en nous
8.3
2014
Le paléontologue Neil Shubin parcourt le monde à la découverte des origines de l'espèce humaine. (NDLR : documentaire sorti en France sur France 5 sous la forme d'une série nommée "Notre part animale", contenant 3 épisodes : "Le poisson en nous", "Le reptile en nous" et "Le singe en nous")
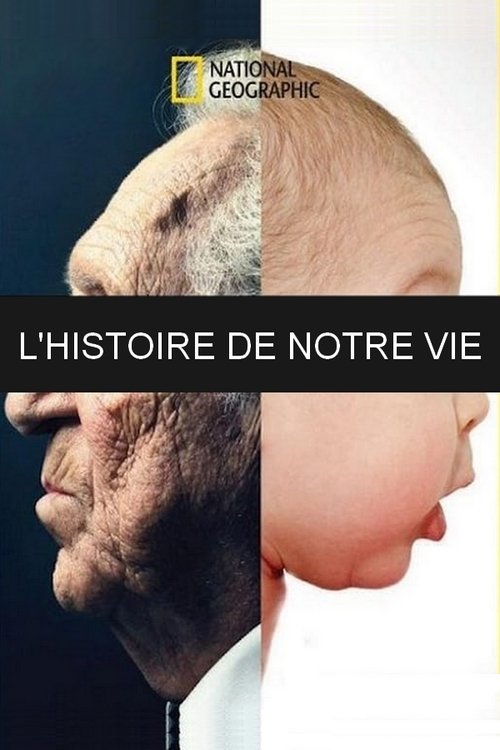
L'Histoire de Notre Vie
9
2017
La fabuleuse histoire du corps humain est vue tout à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. À travers l'histoire fonctionnelle d'Adam, 90 ans, il s'agit de mieux comprendre les effets de la vie et des événements majeurs sur l'organisme : puberté, sentiments, maladies ou excès, tout a une répercussion biologique. De son premier à son dernier souffle, Adam est ainsi passé au crible. Il évoque son existence et son corps, qui se confondent avec ceux de tout un chacun. Cette aventure débute dans les années 1950. Sa fin futuriste est fixée à 2040. Visuellement, de nombreuses animations 3D ponctuent ce docu-fiction.

Le virus qui soigne
0
2015
Renaud, Geoffrey, Mouna et Cassandre, atteints de l’amaurose de Leber, une maladie génétique incurable qui s’attaque à la rétine, ont longtemps pensé être condamnés à la cécité totale. Mais depuis le début des années 1990, les avancées de la science leur permettent d'espérer une guérison. Cet espoir porte le nom de thérapie génique, laquelle consiste à transférer un gène médicament dans l'organisme, à l’aide, le plus souvent, d'un virus modifié. À la fin du siècle dernier, Fabienne Rolling, une biologiste française spécialiste des insectes, parvient, après des années de recherche, à mettre au point le virus capable de délivrer le gène qui devrait rendre la vue aux malades de l’amaurose. Suite à des tests concluants sur des chiens, les premiers essais cliniques sur des êtres humains ont lieu à Nantes en 2011…
